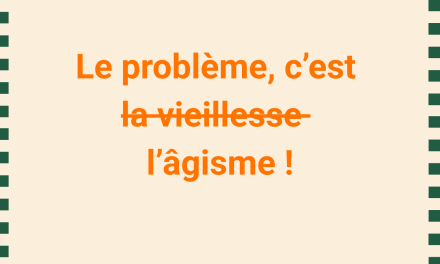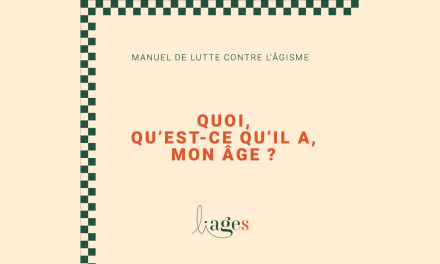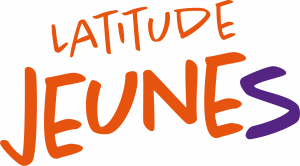De la fin de vie au deuil : l’importance des rites et des rituels

Dans l’usage quotidien, les termes « rite » et « rituel » sont souvent utilisés comme synonymes. Le terme « rite » vient du latin ritus qui signifie « l’habitude, la coutume, l’ordre prescrit » tandis que le mot « rituel » est issu du latin rituales (libri) qui veut dire « les (livres) traitant des rites ».
Le rite peut être défini comme une pratique sociale codifiée qui comprend un ou plusieurs rituels. Ces derniers peuvent relever aussi bien du sacré que du profane. Autrement dit, ils ne sont pas uniquement d’ordre religieux.
Le rite est, comme disait Bernard Crettaz[1], une cérémonie où opèrent des gestes, des paroles et des actions partagés par une communauté. Il a pour fonction de suspendre le temps et à la fois, de permettre le passage.
Les rituels de fin de vie
Créés par et pour la personne mourante et ses proches, ces rituels nous aident à traverser le moment auquel nous sommes confronté·e·s, à lui donner du sens (dans la mesure du possible) et à entretenir le lien affectif. Nous pouvons, par exemple :
- Créer de souvenirs : nous remémorer ensemble des moments marquants, partager des anecdotes, revivre des instants inoubliables ;
- Transmettre des messages : rédiger des lettres à destination des proches pour exprimer ses émotions, souhaits ou confidences ;
- Aménager un espace serein : créer un environnement doux et personnel, avec de la musique, des photos, des bougies ou des objets porteurs de souvenirs.
Dans certaines situations, nous pouvons être submergé·e·s par l’émotion ou l’épuisement au point de ne pas trouver la force ni la clarté pour donner forme à un rituel. C’est là qu’un·e professionnel·le (comme un·e membre de l’équipe soignante) peut, s’iel en a l’opportunité, offrir une présence soutenante. Non pas pour s’imposer, mais pour accompagner et apaiser, tant à la personne en fin de vie qu’à son entourage.
Le rite de la cérémonie funéraire
La cérémonie funéraire permet de nous recueillir et de réaliser un dernier geste d’adieu. Elle nous donne l’occasion d’affronter en groupe la peine liée à la perte de la personne défunte et, d’une certaine manière, de rendre sa mort plus tolérable. Les rituels que nous accomplissons nous aident à repérer le changement, à traverser le chamboulement, à accueillir ce qui nous déborde ou encore à donner du sens à ce dont notre pensée ne peut saisir l’essence.
Dans le cas où le corps n’a pas été retrouvé, il devient essentiel de pouvoir s’appuyer également sur des rituels. Par exemple, se rendre, si possible, sur des lieux symboliques.
Cette cérémonie varie en fonction des convictions, des traditions culturelles ou des volontés personnelles. Certain·e·s préfèrent rendre ce geste d’adieu selon les rites funéraires confessionnels. Sachez qu’il est aussi possible de célébrer une cérémonie funéraire neutre ainsi qu’une cérémonie funéraire selon la conviction laïque.
Enfin, des obsèques sans cérémonie peuvent également être choisies, que ce soit par volonté clairement exprimée de la personne de son vivant ou, en l’absence de directives, par décision de ses proches. Dans ce cas, l’organisation se concentre exclusivement sur les actes liés à la prise en charge du corps : toilette mortuaire, mise en bière, transferts, etc. Même sans cérémonie, un temps de recueillement peut être prévu, lors de moments comme la mise en bière ou juste avant la sépulture.
Les rituels autour et après le deuil
Les rituels autours et après le deuil nous accordent la possibilité de réactualiser la relation intime que nous avions avec la personne décédée. Ces moments de commémoration (c. à d. de « mémoire en commun ») ravivent son souvenir.
Il peut s’agir de cérémonies collectives comme celles organisées aux dates anniversaires de la mort mais également de moments plus intimes. A titre d’exemple : on peut allumer des bougies pour ajouter à la cérémonie une dimension symbolique (source de chaleur, de réconfort, d’espoir…) mais on peut aussi accomplir ce geste avec l’intention de mieux exprimer qui était la personne de son vivant (elle débordait d’enthousiasme, de courage, de passion… elle « avait la flamme »). On transforme ainsi un moment ordinaire en un moment extraordinaire.
C’est aussi dans ces instants qu’une personne formée à ce type d’intervention (psychologue, infirmier·ère, officiant·e, etc.) peut intervenir en proposant un geste symbolique ou en facilitant un moment de rassemblement.
Liages/Mara Barreto/060825
[1] CRETTAZ Bernard (1938-2022) : sociologue, ethnologue et cofondateur de la Société d’études thanatologiques de Suisse romande. Il a organisé les premiers Cafés Mortels en Suisse, au début des années 2000.