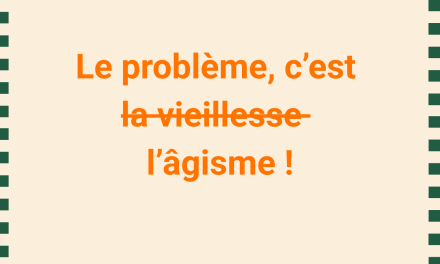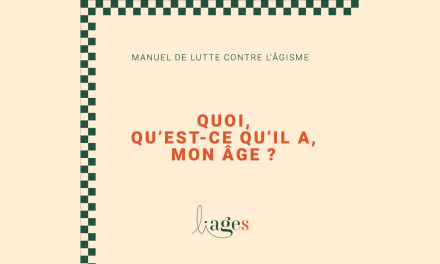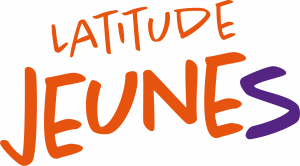Cicely Saunders, pionnière des soins palliatifs – Petite balade historique

Une rencontre fondatrice
Les soins palliatifs virent le jour dans la seconde moitié du XXe siècle. La première à ouvrir la voie fut Cicely Saunders, une Britannique qui se convertit au christianisme évangélique dès sa jeunesse.
Elle commença par des études d’économie à Oxford. Après sa première année, la Seconde Guerre mondiale fut déclarée et la vie changea radicalement, à Oxford comme ailleurs. Cicely Saunders décida alors de s’engager comme bénévole, et entama une formation infirmière. Cependant, des problèmes de santé l’empêchèrent de continuer, notamment les difficultés physiques liées au port des patient·e·s. Elle se tourna alors vers le travail social, où elle put poursuivre son engagement auprès des personnes malades.
C’est dans ce cadre qu’elle fit, en 1947, une rencontre décisive : celle de David Tasma, un réfugié polonais âgé de quarante ans, atteint d’un cancer inopérable. Ce qui commença comme une relation professionnelle devint une amitié profonde, puis un véritable amour. Ils se virent à peine une vingtaine de fois avant sa mort, mais leurs conversations marquèrent à jamais Cicely. Avec lui, elle comprit que les soins de fin de vie ne pouvaient pas se limiter aux antidouleurs : il fallait aussi répondre aux besoins psychologiques, sociaux et spirituels des patient·e·s.
Peu avant de mourir, David lui confia 500 livres en héritage, en lui disant : « Je serai une fenêtre dans ta maison ». Ce geste symbolique renforça la conviction de Cicely Saunders : elle devait créer des lieux d’accueil et d’accompagnement digne.
La réalité du terrain
Quelques années plus tard, un autre épisode vint confirmer sa détermination et affermir sa volonté d’agir. Alors qu’elle travaillait dans un hôpital à Londres, elle fit la rencontre d’un patient atteint d’un cancer de la gorge et en fin de vie. A ce moment, un médecin déclara devant ses étudiants « il n’y a plus rien à faire pour ce malade » et poursuivit son chemin. Cette indifférence la bouleversa. Elle décida alors de se lancer dans la création de lieux adaptés pour accueillir ces malades. C’est ainsi qu’elle imagina les premiers hospices modernes, sortes d’institutions intermédiaires entre ce que nous appelons aujourd’hui des maisons de repos et des unités de soins palliatifs[1].
Confrontée à de nombreuses résistances, elle choisit de entreprendre des études, cette fois en médecine, afin de donner d’avantage de légitimité à son projet. Elle obtint son diplôme en 1957. Ensuite, elle décide de poursuivre son parcours au St Joseph’s Hospice, un établissement catholique où elle travaillait déjà comme assistante sociale. C’est là qu’elle commença à mettre en pratique ses idées : soulager la douleur grâce à un usage adapté de la morphine, mais aussi accompagner les malades dans toutes les dimensions de leur souffrance.
Cicely Saunders laissa ainsi une contribution majeure dans l’usage médical de la morphine. Par ses recherches, elle démontra que ce traitement, bien dosé et administré avec rigueur, constituait un moyen sûr et efficace pour soulager les douleurs cancéreuses.
Elle comprit aussi que réduire les soins uniquement à la gestion de la douleur physique ne suffisait pas. Elle choisit alors de donner un nom à ce constat : « souffrance totale », en rappelant que la souffrance touchait aussi d’autres dimensions : psychologique, sociale et spirituelle.
Jusqu’à St Christopher’s
Grâce à sa persévérance, et après plusieurs années de recherches, de rencontres et de collectes de fonds, Cicely Saunders parvint à fonder, en 1967 à Londres, le St Christopher’s Hospice, le tout premier établissement de soins palliatifs en Europe.
Pendant plusieurs décennies, elle s’impliqua activement dans son fonctionnement. Elle occupa des postes clés, combinant responsabilités cliniques, enseignement et recherche, et contribua à façonner la direction de l’hospice. Elle resta attachée à St Christopher’s jusqu’à la fin de sa vie et décéda en 2005, entourée de l’équipe et des patients·e·s de l’hospice qu’elle avait fondé.
Aujourd’hui, le St Christopher’s existe toujours[2] et offre des soins spécialisés aux personnes atteintes de maladies graves. Il propose des séjours hospitaliers, des consultations externes et des soins à domicile. Au-delà de son rôle de soin, le St Christopher’s est un centre d’enseignement et de recherche reconnu. Il forme des professionnel·le·s de santé, mène des études pour améliorer la prise en charge de la douleur et soutient des initiatives internationales pour promouvoir les soins palliatifs.
D’autres institutions ont évidemment vu le jour par la suite, y compris en Belgique. Toutefois, cela dépasse le cadre de cet article, qui se terminera par quelques points essentiels de la loi belge relative aux soins palliatifs.
La loi belge sur les soins palliatifs
En 2002, le législateur belge a adopté trois lois qui ont un impact incontestable sur le droit médical en général et sur les décisions médicales en fin de vie en particulier : la « loi sur les droits du patient », d’initiative gouvernementale, la « loi relative à l’euthanasie » et celle « relative aux soins palliatifs » initiées par le Parlement.
La « loi relative aux soins palliatifs »[3] dispose que « tout patient a droit à des soins palliatifs lorsqu’il se trouve à un stade avancé ou terminal d’une maladie grave, évolutive et mettant en péril le pronostic vital, et ce quelle que soit son espérance de vie ». Depuis 2016, l’espérance de vie n’est plus un critère limitatif : les soins palliatifs ne sont pas synonymes de soins terminaux.
Même si le terme « palliatif » provient du latin « pallium » qui signifie « le manteau » (celui qui protège, réconforte), les soins palliatifs vont au-delà d’un réconfort, comme nous l’avons vu plus haut à travers l’approche de Cicely Saunders. Un ensemble multidisciplinaire est garanti pour assurer l’accompagnement du ou de la patient·e et ce, sur différents plans (physique, psychique, social, moral, existentiel et, le cas échéant, spirituel). Les plans « existentiel et spirituel » de l’accompagnement s’ajoutent en 2016[4] aux dimensions déjà présentes dans la loi belge de 2002.
Les soins palliatifs offrent la meilleure qualité de vie possible et une autonomie maximale. Dans le cadre de cette optimisation, le terme « famille » fut remplacé en 2016 par les vocables « proches et aidants proches ». Les soins palliatifs tendent ainsi à garantir la qualité de vie pour le ou la patient·e et pour ses proches et aidant·e·s proches.
Démêler les idées reçues
Malgré les avancées et la reconnaissance des soins palliatifs, certaines idées reçues persistent encore, même parmi certain·e·s professionnel·le·s de la santé.
La première consiste à penser que les soins palliatifs ne servent qu’à soulager la douleur. Nous avons vu qu’ils visent à soulager l’ensemble des symptômes présents. La seconde, est que la prise en charge palliative serait destinée uniquement aux personnes dont le décès est imminent. Beaucoup n’y recourent donc qu’à la toute fin de vie. Pourtant, les soins palliatifs peuvent être entamés alors que des traitements sont encore en cours. Ils sont prodigués dès le moment où le ou la patient·e est identifié·e comme palliatif·ve jusqu’à (et y compris) la phase terminale.
Ces malentendus montrent qu’il reste un long chemin à parcourir pour changer le regard sur les soins palliatifs. La loi est un cadre précieux, mais encore faut-il se battre pour que ces soins, au regard de la valeur d’égalité, soient réellement accessibles à toutes et à tous.
Il est donc primordial d’assurer leur accès effectif au niveau des moyens et du cadre, d’augmenter le nombre de lits, de renforcer le financement et le nombre d’équipes mobiles, ainsi que de développer plus encore cet accompagnement en ambulatoire et à domicile. Il faut également créer un cadre juridique pour financer et développer des structures intermédiaires, aussi appelées « middle care », et supprimer la limite de trois mois pour accorder un statut palliatif[5].
Enfin, il est essentiel de continuer à distinguer soins palliatifs et demande d’euthanasie : il s’agit de deux choix distincts, non opposables, voire complémentaires, qui relèvent du droit des patient·e·s concerné·e·s.
Bibliographie
Pour celles et ceux qui souhaitent en savoir plus sur :
Cicely Saunders :
Shirley Du Boulay. Cicely Saunders : The Founder Of The Modern Hospice Movement. SPCK Publishing, 2007
Les soins palliatifs en Belgique :
Liages (2023). Les soins palliatifs : un tour d’horizon [Brochure]. Disponible sur : www.liages.be/soins-palliatifs/
La loi dépénalisant l’euthanasie en Belgique :
Liages (2024). La loi dépénalisant l’euthanasie [Brochure]. Disponible sur : www.liages.be/la-loi-depenalisant-l-euthanasie/
Les brochures Liages sont téléchargeables sur www.liages.be ou disponibles sur demande auprès de notre secrétariat au 02 515 02 73 ou via liages@solidaris.be
Liages/Mara Barreto/071025
[1] Structures existant dans certains hôpitaux, avec un nombre limité de lits. Elles disposent d’une équipe regroupant plusieurs professions (infirmier·ère, médecin, kinésithérapeute, assistant·e social·e, etc.)
[2] St Christophers’s Hospice. Supporting you. Disponible sur : www.stchristophers.org.uk
[3] « Loi du 14 juin 2002 relative aux soins palliatifs. » Parue au Moniteur belge le 26 octobre 2002 et entrée en vigueur le 5 novembre 2002.
[4] « Loi du 21 juillet 2016 modifiant la loi du 14 juin 2002 relative aux soins palliatifs, en vue d’en élargir la définition. » Parue au Moniteur belge le 29 août 2016.
[5] Actuellement, l’accord se fonde, entre autres, sur une estimation de l’espérance de vie. Si cette durée est supérieure à trois mois, le·la patient·e ne peut prétendre à l’aide financière (forfait palliatif).
© 2020 – Liages – dpo@solidaris.be